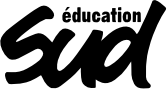Le tribunal administratif (TA) de Paris vient de donner raison à une personnelle d'un établissement de l’académie de Paris contre son chef. Durant un entretien en 2021, ce dernier lui avait adressé des propos violents et arbitraires lui déniant ses droits. Cette personnelle avait alors déclaré un accident de service.
L'accident psychologique reconnu imputable au service
La juge a estimé qu'alors même que le ton employé lors de cet échange n'était pas excessif, cette « remise en cause brutale et arbitraire sans justification tangible » de ses droits devait être qualifiée d'accident imputable au service.
C'est depuis 2021 qu'une jurisprudence très défavorable met à mal, dans le cas où l'accident arrive lors d'un entretien avec un·e supérieur·e hiérarchique, la présomption d'imputabilité obtenue dans la loi en 2019 (art. L822-18 CGFP). Le conseil d'état avait voulu, par cette violente jurisprudence (décision n° 440983), sauvegarder le « pouvoir hiérarchique » (et ses reproches, mesures disciplinaires…) dont la légitimité était socialement contestée par la multiplication des accidents de service psychologiques survenus à cause d'un·e chef·fe. Cependant pour ne quand même pas en faire trop, il avait été obligé de se tempérer en posant un principe permettant, dans les cas les plus flagrants d'abus de chef·fes en entretien, la reconnaissance exceptionnelle de l'imputabilité. Et cette exception avait alors été juridiquement caractérisée dans les cas où « il [est] établi [que l'entretien a] donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ».
Dans notre affaire, c'est sans avocat, simplement avec l'appui de SUD éducation Paris, que l'exercice anormal du pouvoir hiérarchique a pu être établi devant la juge. Et c'est la première fois depuis 2021 qu'un TA prend une telle décision sur la base de cette exception. Ce jugement est maintenant définitif, le rectorat n'a pas fait appel.
Ce qui compte d'abord, c'est la précieuse reconnaissance officielle que l'atteinte à la santé mentale provient du travail. Mais c'est évidemment aussi que cette décision permet de « tirer toutes les conséquences de droit pour l'intéressée, en particulier en ce qui concerne la rémunération, les droits à congés (...) et la prise en charge des frais, notamment médicaux, liés à cet accident ». Lorsque l'accident est reconnu imputable :
- pas de jour de carence le premier jour d'arrêt,
- pas de passage à 90% du traitement les trois premiers mois d'arrêt,
- pas de passage à mi-traitement après trois mois d'arrêt et
- par ailleurs prise en charge par l'employeur —et non par nos cotisations— des frais, notamment de psychologue !
l'erreur d'appréciation du service intructeur du rectoRat
Une fois l'accident déclaré, en 2021, il avait fallu se battre au rectorat contre le service instructeur des dossiers d'accident de service, la DAF (division des affaires financières).
En réalité celui-ci aurait dû reconnaître directement, en un mois, l'imputabilité de l'accident s'il avait correctement analysé ce qu'avait subi l'intéressée. Mais ce service, qui défend trop souvent les chef·fes, a d'abord laissé traîner le dossier pendant des semaines avant de lui coller à la va-vite l'étiquette « pathologie psychologique » qui, pour la DAF, équivaut à « non imputable ». Il s'en est suivi tout un tas de tracasseries injustifiées, notamment lors de séances du conseil médical aussi délirantes que violentes.
Pour pouvoir affronter avec ténacité cette deuxième violence que constitue le déni de reconnaissance de la première violence, celle subie du fait du chef, il a fallu être soutenue et bien conseillée par l'entourage (syndicat, collectif de travail, famille...). En ce sens, la déclaration d'accident de service, qui est une démarche individuelle, comporte aussi une dimension collective. Donc ici, la décision de non reconnaissance d'imputabilité de la DAF a été contestée par l'envoi d'un recours puis par l'introduction d'une requête au TA. Au final, la juge a estimé que la DAF avait commis une « erreur d'appréciation » et a enjoint le rectorat de reconnaître l'imputabilité de cet accident de service, ce qui a été fait, certes après une procédure bien trop longue.
Un encouragement pour les nombreuses luttes à mener
Cette victoire constitue un encouragement à déclarer, dans les cas opportuns, des accidents de service (y compris sans arrêt de travail) que ce soit pour des atteintes psychologiques du fait du management toxique ou pour les autres atteintes à la santé du fait du travail. Elle incite aussi, en cas de refus d’imputabilité par le service instructeur (DAF, service RH à l’université), à mener la bataille âpre pour la faire reconnaître.
Faire de la déclaration d'accidents de service, notamment psychologique, un objet de discussion collective entre collègues contribue à atténuer le diviser pour mieux régner distillé par les chef·fes et ainsi à ne pas laisser seul·es les collègues qui viennent de subir un tel accident. Dans certains établissements délétères, plusieurs personnel·les sont amené·es à déclarer un accident de service ou une maladie professionnelle. Pour SUD éducation Paris, ces démarches individuelles doivent s'articuler avec la lutte collective locale pour de bonnes conditions de travail et contre la violence des hiérarchies toxiques.
Ces luttes sont à mener que cette violence soit insidieuse ou éclatante et quel·les que soient les chef·fes l'exerçant : inspecteurices, IEN et directeurices du 1er degré, chef·fes d'établissement du 2nd, chef·fes de service et directeurices de l’université, et autres pseudo & petit·es chef·fes.
SUD éducation Paris continuera de lutter pour que l'instruction des dossiers d'accidents de service et de maladie professionnelle soit menée véritablement en faveur des personnel·les. Cela veut dire, en plus des défenses individuelles, faire changer à court terme les pratiques des services instructeurs et du conseil médical (lié à la DAF) et à moyen terme les réglementations et jurisprudences défavorables.
Contre le management toxique, SUD éducation Paris appelle les personnel·les :
-
à mener régulièrement sur nos lieux de travail les discussions collectives qui soudent les équipes face aux pratiques toxiques de l'encadrement (en heures d'information syndicales, en AG ou informellement) ;
-
à accompagner collectivement les collègues qui subissent des accès de violence hiérarchique sous quelque forme qu'elle soit ;
-
à se faire soutenir et conseiller, avant même la consultation d'un·e médecin, sur l'opportunité et l'intérêt de déclarer un accident de service pour les titulaires ou un accident du travail pour les contractuel·les, en particulier dans les cas d'atteintes psychologiques survenues en entretien avec un·e chef·fe ;
-
à contester les refus d’imputabilité en se faisant soutenir et conseiller ;
-
à utiliser tous les outils de la lutte syndicale pour mener des actions collectives contre la violence hiérarchique.